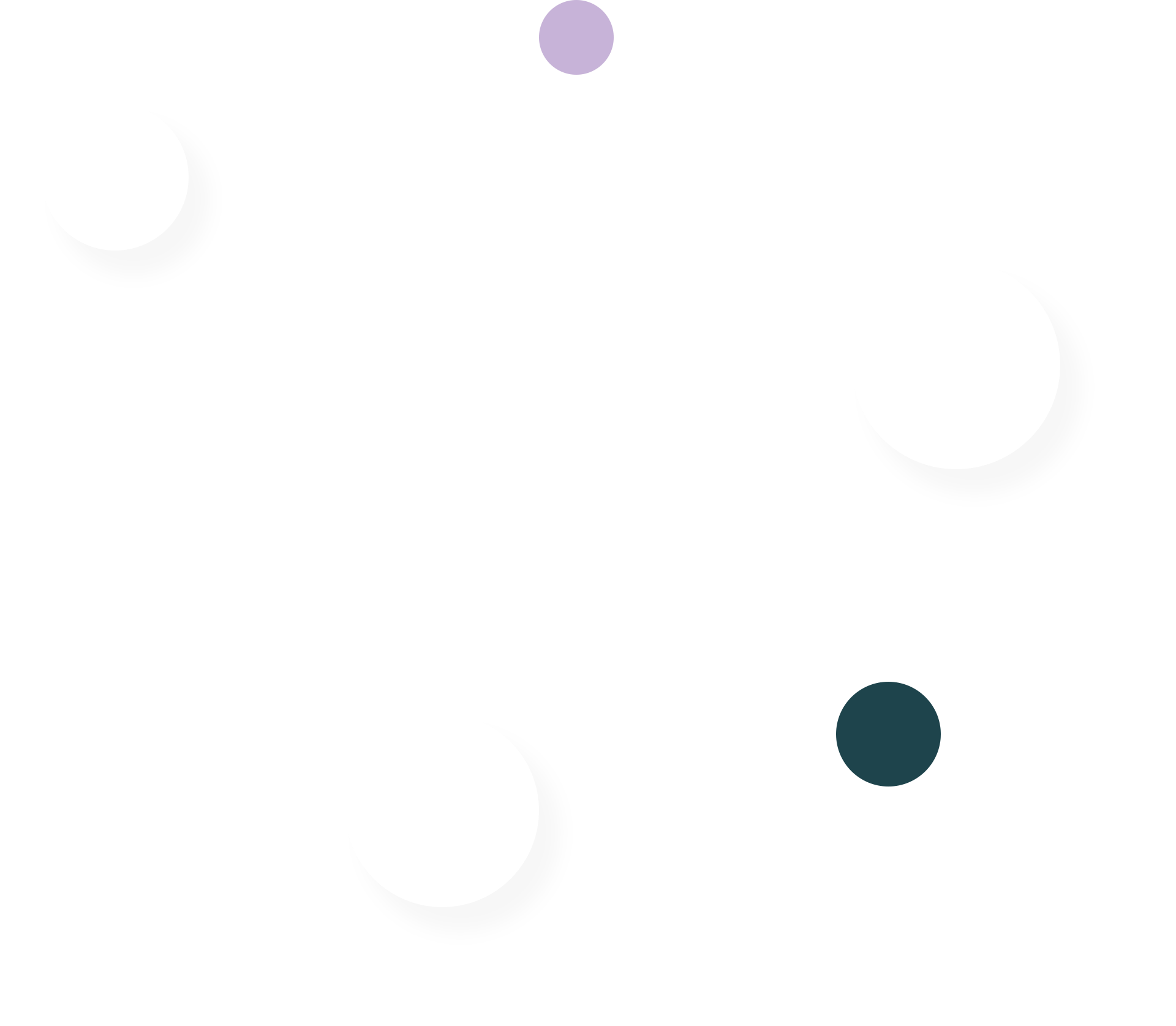Hans Prinzhorn (né en 1886 et décédé en 1933), psychiatre et psychothérapeute allemand, a analysé des milliers d'oeuvres créés en milieu psychiatrique. Il remarque que les pulsions poussent les auteurs à créer l'essence même de leur vie, de leur intimité, de leur âme, visant leur processus de guérison.
Il bouleverse le regard des artistes et de la société dans son livre « Expression de la folie » Il fut une source profonde pour Paul Klee, Max Ernst, Jean Debuffet.
Les œuvres de « fous » étaient alors exposées aux côtés d’œuvres d’avant-garde (expressionnisme, surréaliste, cubisme, etc.) dans le seul but de ridiculiser ces dernières.
Qu’est-ce que la folie ? Quel est le moment ou la limite qui nous semble l’être, entre la « norme » de monsieur et madame tout le monde et la signification de la « folie » Qui peut oser en parler dans le domaine touchant l’art et de toute créativité ?
En 1945, Adrian Hill, peintre anglais, écrivain, éducateur, a appris à soulager sa tuberculose en accordant une place à la pratique artistique. Il mit en évidence les bienfaits de l’art-thérapie lui permettant de s'apaiser, de diminuer grandement ses douleurs.
En cette même période, c'est l'apogée du Dadaïsme qui est né en 1916 à Zurich, mouvement de jeunes artistes européens qui avaient fui la première guerre mondiale, ce courant dans lequel les artistes ne souhaitaient plus reproduire le réel, mais mettaient en avant une recherche intérieure, ils remettaient en cause les contraintes idéologiques, les conventions esthétiques. Plutôt décrits comme extravagants, ils souhaitaient la libre expression, celle qui pouvait dénoncer, percuter, provoquer, et amener le spectateur à réfléchir entre-autre sur les fondements de la société. Ce mouvement fut dans les prémices de l’art-thérapie.
Parallèlement Jean Dubuffet (1901 à 1985), artiste peintre et sculpteur français se passionnait pour les oeuvres effectuées en hôpitaux psychiatriques, les créations des patients étaient considérées comme l'art des marginaux, l'art des aliénés, hors de toute influence culturelle et artistique. Debufet a ouvert la voie à une nouvelle approche de la création qui aspire à libérer l’art de « l’asphyxiante culture » dont il dénonce le caractère répressif. Il s’intéresse alors à ce qu’il appelle « l’art brut », celui de la différence et de l’innocence, comme une volonté de faire table rase d’un art élitiste et hermétique.
Dans les années 60, Donald Wood Winnicott, psychanalyste post freudien anglais, va poser les fondements de l'art-thérapie s'appuyant sur le développement de l'enfant depuis sa naissance. C'est en étant ouvert aux possibles et créatif que l'on découvre le Soi.
En 1964, les ateliers d'art-thérapie voient le jour à Paris, à l'hôpital de Sainte-Anne, spécialisé dans la psychiatrie et les neurosciences.
Aujourd’hui l’art-thérapie a vu le jour dans les hôpitaux, les établissements socio-médicaux, les hôpitaux psychiatriques, les écoles, garderies, institutions spécialisées, les institutions carcérales et en tant que suivi thérapeutique pour son évolution personnelle.